
  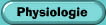
| Les relations interspécifiquesBien qu'elles concernent principalement les relations animales, certains types de relations sont possibles chez les végétaux. Si le classement des relations en différents types simplifie la compréhension des interactions entre êtres vivants il faut retenir que ces relations peuvent évoluer au cours du temps et peuvent également être associées à d'autres comportements.
Les relations pacifiquesToute relation n'est pas conflictuelle (heureusement !). Cela peut aller de la simple ignorance jusqu'à une relation plus passionnée où il devient difficile de se séparer ! Le neutralismeLes espèces en présence s'ignorent superbement ! C'est généralement le cas quand l'habitat, la nourriture, l'espace occupé ou la période d'occupation sont différents, il n'y a donc pas de conflits d'intérêts ! Donc deux espèces neutres entre elles ont un biotope différent ou une zone du biotope bien différenciée. On peut observer ce type de relation dans une forêt où les passereaux sont très nombreux mais où il est rare d'observer des différents. Chaque oiseau occupe une strate spécifique, dans les buissons, dans les arbustes, au sol... Si la strate occupée est la même, la nourriture sera différente (vers, graines...). La protocoopérationC'est le cas quand deux espèces s'associent pour en tirer chacune un bénéfice. L'exemple le plus connu est celui du bernard l'hermitte (pagure) qui transporte sur sa coquille des anémones de mers. Ces dernières protègent et camouflent le crustacé tandis que celui-ci les fait circuler ce qui facilite la prédation (à noter que cette relation peut aboutir à une relation de type mutualisme chez certaines espèces). On peut citer aussi le cas des animaux (poissons, oiseaux) nettoyeurs qui enlévent et se nourissent des parasites trouvés sur les animaux qu'ils nettoient. Ce type d'association peut être interrompu sans dommage à tout moments. Le commensalismeDans ce cas seule une espèce tire un bénéfice de l'association, l'autre n'en est pas accomodée. C'est par exemple le cas des transports "gratuits" comme les ongulés pour les hérons garde-boeufs. Cela ne gène pas le bovin tandis que l'oiseau peut apercevoir des proies s'échappant à l'approche du mammifère. On peut considérer aussi le cas des insectes ou d'autres animaux transportant le pollen, ou des graines au profit de végétaux. Ce type de relation (transport) est appelée phorésie ou épizoïtie. Certains animaux "squattent" les terriers d'autres espèces. Ce sont généralement des insectes qui profitent des abris et des restes de mammifères terricoles (on parle dans ce cas de pholéobiose ou endoécie). Il y a aussi des microorganismes (ou de petits organismes) qui peuvent vivre à l'intérieur d'autres organismes sans le géner mais aussi sans lui apporter grand chose (on appelle cela l'inquilinisme). Le cas le plus frappant est celui d'une petite espèce de poisson vivant à l'intérieur d'une holothurie. Ces cas d'inquilinisme sont à la frontière des relations de type mutualisme ou parasitisme. Le mutualismeC'est une relation plus poussée que
l'inquilinisme. Ici les deux espèces protagonistes
tirent avantages de la relation qui devient obligatoire. On
parle aussi de symbiose. Ainsi la flore intestinale
correspond à un ensemble de microorganismes vivant en
symbiose avec leur hôte. Tout en se nourrissant dans
un milieu agréable (chaud et stable), ils permettent
la digestion des aliments ingérés. C'est plus
particulièrement le cas chez les ruminants qui
ingérent une grande quantité de cellulose,
normalement non assimilables, dégradées par
les bactéries du tube digestif. On peut citer aussi
le cas des termites et des
flagellés qui leur permette de digérer les
fibres de bois ingérées. Les poissons
amphiprion qui vivent dans les anémones sont
immunisés contre le venin des tentacules, ils sont
protéger par l'anémone et nourissent en
échange celle-ci des proies qu'ils attrapent. Les relations conflictuellesCe sont les plus courantes. La prédationC'est le fait de se nourrir d'un être vivant. Les
proies peuvent être diverses, ou au contraire
très spécifiques. Le choix des proies
dépend de plusieurs facteurs (lieu, période,
âge du prédateur..) mais il s'agit le plus
souvent d'individus affaiblis (malade, blessé, jeune
ou âgé). Le parasitismeC'est une association, obligatoire, d'un individu avec un autre, ne profitant qu'à un seul protagoniste qui vit au dépens de l'autre. Il peut s'agir d'un ectoparasitisme (extérieur) ou d'endoparasitisme. Pour le parasite, il faut établir une rencontre avec son futur hôte, celle-ci peut se faire au hasard (avec notamment la dissémination d'une très grande quantité d'oeufs) ou être favorisée (rythme biologique, biotope). Les végétaux sont aussi victimes du parasitisme et certaines plantes sont des parasites vis à vis d'autres végétaux. La compétitionIl s'agit de la lutte de deux ou plusieurs espèces pour une même ressource (niche écologique, nourriture...). Cette relation est souvent liée à celle de la prédation. La compétition peut avoir des effets bénéfiques en favorisant les adaptations. Elle concerne également les végétaux : le port d'un chêne est bien différent quand celui-ci est isolé au centre d'une prairie que quand il est situé dans une forêt. C'est la compétition pour la lumière qui entraîne ce port en hauteur en forêt. | |||||||||||||||||||||||||